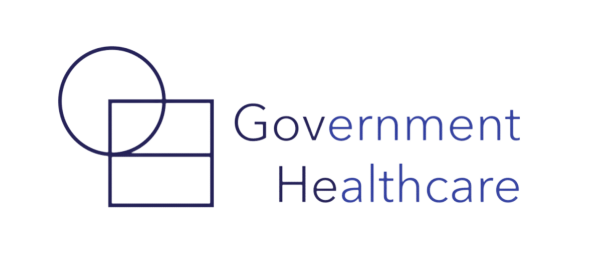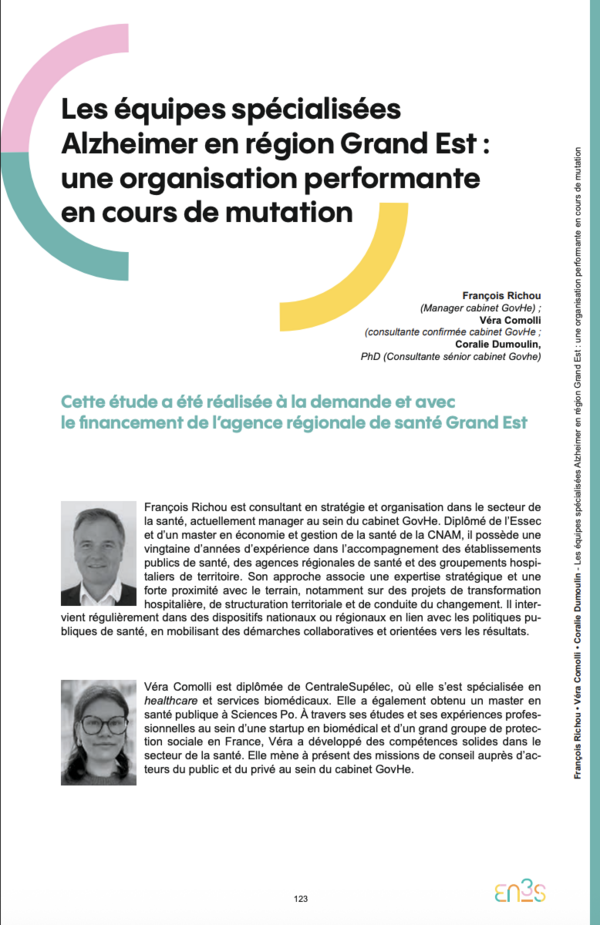Filière Santé et Innovation : Quelles stratégies pour faire de sa métropole un pôle d’attractivité des entreprises et centres de recherche en santé ?
Dans un monde en constante évolution technologique, la filière santé joue un rôle crucial dans le développement économique des métropoles. La Santé est en effet une activité en croissance forte et pérenne qui peut s’appuyer sur un système de santé puissant en France. C’est par ailleurs un moteur d’innovation et d’attractivité pour les entreprises et les talents. Structurer une filière santé performante dans un écosystème urbain exige une vision claire, des collaborations solides entre le public et le privé, des infrastructures adaptées, et surtout une lisibilité de la filière qui facilite l’implantation de nouveaux acteurs. Cet article propose une réflexion sur les stratégies clés pour dynamiser la filière santé dans les métropoles. Il s’appuie sur le retour d’expérience de trois métropoles Lille, Lyon et Strasbourg qui ont réussi depuis plus de vingt ans à faire émerger une identité forte en santé.
Les stratégies pour structurer un écosystème santé attractif
1.1 Une structure de coordination solide pour un écosystème harmonieux
Le prérequis pour envisager d’affirmer un pôle santé sur un territoire est la présence d’un ou plusieurs acteurs de soins, de recherche et de formation d’envergure comme un CHU et/ou un Centre Lutte contre le Cancer comme Gustave Roussy à Villejuif.
La réussite d’un écosystème santé repose sur un organe de coordination qui rassemble les quatre principaux acteurs : le CHU ; la collectivité locale, la principale ville ou métropole ; les industriels ; et les universités. L’expérience des métropoles de Lille, Lyon et Strasbourg montre que le démarrage de cette coordination varie suivant les lieux, avec un rôle essentiel de la collectivité locale pour créer la dynamique. Ce modèle collaboratif permet de créer une vision stratégique commune, de favoriser l’innovation et de renforcer la cohérence des actions menées au sein de la filière. Par exemple, Eurasanté à Lille illustre comment une gouvernance partagée entre les autorités locales, les hôpitaux, et les entreprises permet d’assurer la cohésion et de maximiser l’impact des projets.
Dans cette configuration, le CHU ou le pôle de recherche joue un rôle central en tant que nœud de l’écosystème de santé : il est le porteur des essais cliniques, soutient la recherche appliquée, et participe aux initiatives de développement en partenariat avec les start-ups et les entreprises du secteur.
1.2 La proximité entre start-ups et centres de soins pour accélérer l’innovation
Pour que l’innovation se développe efficacement, il est essentiel que les start-ups aient un accès direct aux services de soins. La proximité géographique avec les centres hospitaliers et les institutions de santé permet aux jeunes entreprises de tester rapidement leurs innovations technologiques, de bénéficier de retours concrets et d’adapter leurs solutions en fonction des besoins des praticiens et des patients.
NextMed à Strasbourg ainsi que Eurasanté à Lille incarnent ce modèle en regroupant sur un même site (ou à proximité) des start-ups, des chercheurs et des hôpitaux, créant ainsi un environnement propice aux échanges et aux collaborations. Cette proximité améliore la réactivité, favorise les tests de produits en conditions réelles et accélère le développement de solutions médicales de pointe.
Adapter l’offre de formation aux besoins de la filière santé
Un écosystème performant doit également veiller à adapter l’offre éducative des universités et écoles aux besoins des acteurs, entreprises et centres de recherche en santé. En mettant en relation les écoles et les universités avec les entreprises, les métropoles peuvent garantir que les compétences enseignées correspondent aux besoins réels des entreprises de la filière santé. Les programmes interdisciplinaires et les chaires spécialisées sont des outils précieux pour former des talents prêts à relever les défis du secteur.
2.1 Développer une offre foncière et immobilière dédiée à la santé
L’accessibilité du foncier et la disponibilité de l’immobilier adapté sont des éléments cruciaux pour attirer les entreprises et les start-ups dans une métropole. Une offre immobilière structurée doit inclure des espaces modulables et évolutifs, comme des laboratoires et des bureaux, permettant aux entreprises de se développer et de s’adapter aux nouvelles exigences de l’innovation médicale.
Le biodistrict de Gerland à Lyon offre des espaces de travail spécialisés et des zones dédiées à la recherche médicale et aux biotechnologies. Cependant, l’expérience de Lyon montre l’importance de bien ajuster les infrastructures aux besoins réels. Par exemple, les salles blanches, bien qu’extrêmement technologiques et parfaitement conformes aux standards de propreté, se révèlent aujourd’hui coûteuses pour le biodistrict lui-même. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la sophistication des installations et la maîtrise des coûts pour garantir la viabilité économique de l’écosystème.
2.2 Les perspectives : entre attractivité et compétitivité
Enfin, structurer une filière santé performante permet aux métropoles de gagner en attractivité, tant pour les talents que pour les entreprises internationales. Les villes qui réussissent à se positionner comme des hubs d’innovation en santé peuvent attirer des investissements conséquents, créer de nouveaux emplois et contribuer à l’amélioration des soins de santé.
Cependant, la compétitivité d’une métropole ne peut être durable sans une vision à long terme et une stratégie cohérente. Les métropoles doivent constamment adapter leur offre, en tenant compte des évolutions technologiques et des besoins croissants en matière de santé publique. Il s’agit donc d’investir dans des projets structurants, tels que les entrepôts de données de santé ou les bioclusters, tout en favorisant la transition entre la recherche et la commercialisation des innovations.
Conclusion
En conclusion, structurer une filière santé dans une métropole ne se limite pas à attirer des entreprises ou à développer des infrastructures. Il s’agit de créer un écosystème intégré où tous les acteurs (chercheurs, entrepreneurs, collectivités, hôpitaux) collaborent pour innover. Les métropoles qui réussissent à dynamiser leur filière santé sont celles qui comprennent l’importance de la collaboration, de l’innovation technologique, et de l’attractivité des talents. En adoptant des stratégies claires et en investissant dans les bons leviers, les villes peuvent transformer leur filière santé en un véritable pilier de leur développement économique.